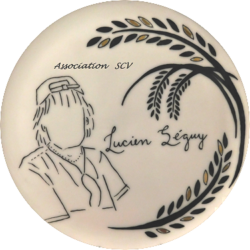Par Noël Deneuville

Noël Deneuville, Paysan dans la Nièvre depuis 30 ans, et acteur de l’agriculture de conservation des sols (ACS) à la ferme du Chaumont. Avec « SCV Lucien Seguy », je veux vous raconter l’histoire d’une limace, non pas comme une ennemie à abattre, mais comme le symptôme d’un déséquilibre que nous avons créé. Comprendre son apparition, c’est ouvrir la voie à une agriculture robuste et durable. Voici mon parcours et mes réflexions au sujet de cette fameuse limace.
Aux origines du problème : L’évolution de l’agriculture dans les années 1960 et la quête du « propre »
Les limaces sont devenues une préoccupation majeure pour les agriculteurs français, notamment dans les zones de grandes cultures comme le colza, le blé ou les cultures maraîchères. Leur prolifération semble liée à une combinaison de facteurs environnementaux et de pratiques agricoles modernes. Parmi les hypothèses plausibles, l’utilisation massive d’insecticides pourraient avoir joué un rôle clé dans ce phénomène. Cet article explore cette problématique, en s’appuyant sur des données historiques et des analyses critiques.
Dans les années 1960-1970, l’agriculture change de visage avec la mécanisation en développement, l’apparition des moissonneuses-batteuses qui facilitent l’essor des surfaces de colza, dont les surfaces passent de 100 000 hectares à 1,5 million aujourd’hui. Ce n’est pas une critique contre la culture du colza qui au contraire a permis pour nos zones intermédiaires d’obtenir des marges confortables.
Pour protéger cette culture des insectes ravageurs – altises, charançons –, les conseils techniques de l’époque font appliquer des insecticides comme le DDT ou les organophosphorés, qui ne font pas de distinction : ils éliminent aussi les insectes utiles, comme les carabes, prédateurs des limaces.Dans les années 1950-60, on arrosait nos champs, y compris le colza, avec des matières actives insecticides comme le DDT, un insecticide puissant mais aveugle. Ces insecticides tuait les ravageurs dangeureux, mais aussi les carabes utiles qui eux pourtant avaient la mission de régulation des limaces.
Ce déséquilibre écologique a réduit la régulation naturelle des populations de limaces, favorisant leur multiplication en l’absence des prédateurs disparus….! En effet, la limace, si les conditions lui sont favorables, peut se reproduire très très vite….
Les ravageurs du colza
- Limaces. Le colza est une des cultures les plus sensibles aux limaces. …
- Grosses altises. La grosse altise apparaît en septembre dans les parcelles de colza où elle va pondre ses œufs. …
- Pucerons. …
- Charançon du bourgeon terminal. …
- Charançon des tiges. …
- Méligèthes. …
- Charançon des siliques.
Mais ce n’est pas tout. Avec le colza arrivent des désherbants efficaces, conçus pour rendre les parcelles « propres ». Résultat : des champs nus, sans adventices ni diversité, un mono-menu pour la biodiversité. Les quelques limaces présentes n’ont plus d’autre choix que de se rabattre sur le seul colza restant , amplifiant les dégâts.
À cela s’ajoute le travail mécanique du sol : s’il peut déranger quelques limaces, il détruit aussi leurs sources d’alimentation variées, tout en perturbant gravement les carabes, ces précieux prédateurs, entre autres, qui régulent leurs populations.
Depuis quelques années, on constate aussi une accélération de la présence de petits escargots minuscules qui occasionnent les mêmes dégâts que leurs collègues limaces ….Ces escargots ne sont plus régulé correctement par les oiseaux des champs en baisse inquiétante …
Évolution de l’utilisation des insecticides depuis 1960
Entre 1945 et 1985, la consommation mondiale de pesticides, dont les insecticides, a doublé tous les dix ans. En France, les années 1960 marquent le début de cette hausse exponentielle, avec une généralisation des produits organochlorés comme le DDT (interdit en 1972). Dans les années 1970-1980, les organophosphorés (ex. malathion) prennent le relais, suivis plus tard par les néonicotinoïdes dans les années 1990. Selon les données disponibles, les ventes d’insecticides en France ont été multipliées par 3,5 entre 2009 et 2018, passant d’environ 5 000 tonnes à plus de 17 000 tonnes de substances actives par an. Cependant, depuis 2019, une baisse est observée, avec une réduction de 19 % des ventes totales de pesticides entre 2012-2017 et 2021, incluant une diminution spécifique des insecticides les plus toxiques.
L’essor des produits antilimaces
Face à la prolifération des limaces, les agriculteurs ont recours à des produits antilimaces, principalement des molluscicides comme le métaldéhyde ou le phosphate de fer. Si leur usage était marginal avant les années 1970, il s’est intensifié avec l’augmentation des surfaces de colza et des grandes cultures. Les données précises sur les volumes avant 2000 sont rares, je n’ai pas trouvé de chiffres précis sur l’évolution des volumes de produits anti-limace mise en oeuvre. Cette utilisation reste toutefois bien inférieure à celle des insecticides, reflétant une réponse ciblée à un problème spécifique plutôt qu’une stratégie globale.
Le piège des intrants : un déséquilibre en cascade
Les insecticides ont aggravé le problème. Prenez les méligèthes, ces petits coléoptères du colza : en quelques années, ils ont résisté aux traitements qui leur étaient destinés, s’adaptant là où les carabes, eux, disparaissaient. Sans prédateurs, les limaces ont prospéré. Les désherbants, en éliminant toute nourriture alternative, les ont poussées vers nos cultures. Et les anti-limaces ? Une chimie idiote, non ciblée, qui empoisonne et perturbent l’ensemble des prédateurs qui s’en nourrissent (des hérissons, insectes et autres oiseaux). Vouloir exterminer toutes les limaces parce qu’elles grignotent quelques feuilles, c’est absurde. Elles ont un rôle : elles décomposent la matière organique et nourrissent une chaîne d’animaux essentiels.
Pour les chasseurs, souvent agriculteurs eux-mêmes, la baisse du petit gibier – perdreaux, faisans – est un mystère qu’ils attribuent à la météo ou à des causes farfelues. Je ne suis pas sûr qu’ils mesurent le lien avec nos pratiques. En tuant les insectes avec les insecticides, on a privé ces oiseaux d’une alimentation facile, et leur rôle régulateur sur les limaces s’est éteint.
Ma stratégie : redonner sa place à la nature
À mes débuts, j’ai suivi cette logique. Insecticides, anti-limaces, désherbants : je voulais des parcelles impeccables. Mais j’ai vite vu les quantités d’anti-limaces grimper sur ma ferme. « Il fallait réagir vite », me suis-je dit. Ce n’était pas tenable.
L’expérience de Lucien m’a été précieuse….il ne connaissait pas plus que ça la problématique limace en France, mais il m’a fait comprendre avec ses autres expériences pour d’autres ravageurs que la solution chimique était à raisonner avec des pincettes et que la solution biologique était bien plus intéressante

Face à cette impasse, j’ai tout repensé. Voici comment je gère les limaces aujourd’hui :
- Zéro intrants chimiques : Plus d’insecticides ni d’anti-limaces sur 100% de la ferme. (diminution de la sole colza et remplacement par la culture de la moutarde) J’ai vu les prédateurs revenir naturellement. Les refuges à limaces – résidus végétaux, sols humides –(qui sont aussi le repère des prédateurs de la limace) ne posent pas de problème quand les carabes et autres auxiliaires font leur travail continuellement…..
- Plantes de service et leurres : J’intègre des graines très appétentes pour les limaces – colza, tournesol – dans mes semis. Elles détournent leur attention des cultures principales. D’autres plantes, comme le lin ou le soja, jouent des rôles complémentaires sur d’autres ravageurs ou la fertilité du sol. l’expérience avec la limace m’a permis d’extrapoler ma réflexion à bien d’autres problématiques …… Pas de concours de champ « propre » ici : un maximum de diversité, de bio-diversité, c’est une assurance-vie pour mes parcelles de sols vivants.
- Semis adaptés : S’il le faut je sème un peu plus tôt pour que mes colzas et céréales prennent de la vigueur avant les pics de limaces, avec une fertilisation localisée pour les booster. ( assurance graines de tournesol pour les semis de colza)
- Biodiversité dans les parcelles : Sans être opposé aux haies – elles ont leur utilité –, mais je préfère multiplier la diversité directement dans l’ensemble de mes champs avec des couverts permanents. C’est là que se joue l’équilibre en local. La pratique du SCV , a l’avantage de créer un panel de refuge (à base de plantes couvertures du sol) à toute une gamme de prédateurs bien cachés et surtout en sécurité vis à vis d’ oiseaux à la recherche d’insectes ( il n’en est pas de même en sol nu et travaillé mécaniquement)
- Augmentation des densités de semis des cultures (la part de la biodiversité) surtout en bordure de parcelle boisée
Mon expérience a mal débuté, je l’avoue. Comme tout le monde, j’ai suivi le modèle dominant. Mais quand j’ai vu l’escalade des intrants, j’ai compris : la solution n’est pas de lutter contre les limaces, mais de coexister avec elles.
Une vision globale pour l’avenir
La nature fonctionne en cycles équilibrés depuis toujours. Perturber cet équilibre – tuer les insectes utiles, appauvrir les sols, priver les oiseaux – est une catastrophe pour nos parcelles. Avec « SCV Lucien Seguy », nous proposons une autre voie : produire une alimentation saine et de qualité, en respectant ces cycles. Mes solutions prouvent que c’est possible. Les limaces ne sont pas à exterminer ; elles nous rappellent que tout est lié.
Certes quelques limaces en équilibre sont toujours présentes sur ma ferme, mais il faut intégrer qu’elles sont nécessaire à la survie des carabes ….Et, quelques oiseaux réussissent à consommer quelques carabes, Mais par contre , aujourd’hui , l’équilibre naturelle est rétabli correctement et le fait de toujours prévoir, anticiper un leurre appètent-limace aux périodes sensibles (levée des cultures) me permet de dormir tranquille….!

Conclusion : un pas vers une agriculture robuste
Si vous avez lu cet article jusqu’au bout, bravo : vous êtes sur la bonne voie pour réfléchir à l’avenir d’une agriculture durable. À la ferme du Chaumont, j’ai appris qu’une parcelle n’a pas besoin d’être « propre » pour être productive. Elle doit être vivante avec des sols vivants. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une limace, demandez-vous : et si elle était là pour nous guider vers du raisonnable ?