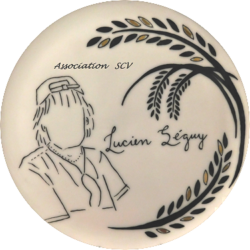Les limaces peuvent occasionner de gros dégâts sur les cultures, surtout sur celles de printemps en début de cycle. Il est donc important d’anticiper le risque limaces dans sa stratégie, surtout lorsque l’on cherche à réduire le travail du sol et les intrants.
Après avoir abordé la technique du semis nature technique opportuniste de semis à la volée sans travail du sol, Noël Deneuville nous parle de sa stratégie de gestion des limaces… sans anti-limaces. Sorti d’un historique de pratiques conventionnelles, il a décidé de changer son fusil d’épaule et a commencé à implémenter le semis direct sous couverts vivants il y a une vingtaine d’années. Parti d’une situation avec une forte pression limaces, il a appris à travailler avec la nature pour gérer le problème autrement.
Dans L’Agronomie & Nous, Noël nous partage 3 points clés à avoir en tête pour aller vers une réduction de la chimie dans gestion de cette problématique.

Un système de semis direct sous couverts vivants
Il est important de garder une vision globale de la régulation naturelle qui s’opère dans les systèmes agricoles. En termes de proportion, des études ont montré que l’efficacité de la gestion des ravageurs se fait à 10% grâce à la chimie, à 40% grâce à la sélection variétale et à 50% grâce aux auxiliaires de cultures. Cela permet de souligner l’impact des régulations écosystémiques sur la productivité agricole.
90% des auxiliaires ont besoin de micro-habitats (haies, bandes enherbées, etc) et d’une diversité de ressources alimentaires pour assurer leur cycle complet de reproduction, contre 50% des ravageurs. Les pratiques culturales jouent donc un rôle essentiel sur le développement des auxiliaires. Aller vers des pratiques d’agriculture de conservation des sols permet d’instaurer une forme de lutte par conservation des habitats des auxiliaires. Le carbone est une des bases de ce processus de régulation. La mise en place de couverts végétaux permet de nourrir le sol, de favoriser l’activité biologique et d’avoir un pool d’auxiliaires comme les carabes qui vont réguler les populations de limaces.
« Au démarrage, j’avais une grosse pression des limaces. Tous les facteurs s’y prêtaient : une part importante de colza dans la rotation, une texture de sol qui préserve l’humidité, l’usage régulier d’insecticides. Historiquement, la problématique limace « gênante » n’est apparue qu’après les premières applications d’anti-limaces . La Nature tient son système en 2 mots : cycle en équilibre. Suite à une réflexion avec Lucien Seguy, j’ai décidé d’arrêter les insecticides pour baser ma stratégie de lutte sur la régulation naturelle. J’ai réduit la sole de colza et ai commencé à mettre en place des techniques de colza associé et de colza leurre ».
Nourrir les limaces permet de réduire les dégâts sur les cultures
Noël a commencé à apporter de la nourriture aux limaces pour réduire les dégâts sur ses cultures. L’idée est de rajouter des lots de colza pour accompagner les cultures au moment du semis de blé ou de maïs (4-5 kg/ha selon les conditions), puis de revenir en semer à la volée si besoin. Il ajoute également du soja à hauteur de 40 kg/ha avec le maïs. Les graines de nyger sont aussi très appétentes pour les limaces (mais onéreuses si on ne les produit pas sur place). Quand la culture à semer est du colza, mieux vaut éviter de l’implanter derrière une céréale à paille. Les résidus pailleux fournissent des abris aux limaces contre le soleil et la chaleur. Dans la rotation, mieux vaut implanter le colza derrière une légumineuse.
« On constate que la limace a une mémoire alimentaire : quand elle est habituée à manger du colza, elle va continuer à manger du colza. Tant qu’il y en a sur la parcelle, l’impact sur la culture en place est réduit. Malgré les pertes, je me suis tenu à ne pas mettre d’insecticides ni d’anti-limaces. Au bout de 3 ans, un équilibre écosystémique s’est établi. Il est important de préciser que je suis dans un système de semis direct sous couverts vivants. Cela ne fonctionne que si le sol est toujours couvert. Si la parcelle est nue, les limaces mangent les graines des cultures. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser de l’anti-limaces ».
Favoriser le démarrage rapide des cultures
Il faut trouver un équilibre dans la date de semis pour mettre toutes les chances de son côté.
« La période cruciale est au moment du semis. Une fois que la culture est bien développée, la pression limaces a tendance à diminuer. Il faut semer dans des conditions poussantes. J’ai plutôt tendance à retarder mes dates de semis au printemps pour avoir les meilleures conditions. Dans des conditions froides, la culture met du temps à levée, c’est du pain béni pour les limaces. À l’automne, c’est l’inverse. Mieux vaut semer un peu plus tôt pour que les céréales fassent de la biomasse rapidement. À l’arrivée de l’hiver, la pression limaces ralentit ».
La fertilisation joue également un rôle crucial. En sortie d’hiver, les terres sont froides donc le démarrage est lent. Apporter une fertilisation localisée ou starter permet d’optimiser le développement racinaire en augmentant la disponibilité des éléments nutritifs pour les cultures.
« J’apporte des bouchons organiques dans la ligne de semis (100 à 120 kg/ha à 10% d’azote). La teneur en azote est plus faible que des formes d’azote chimique, mais la forme organique améliore l’efficience d’assimilation. De plus, l’azote organique ne gêne pas la germination de la jeune plantule. Je ne suis pas en agriculture biologique, j’apporte aussi de l’azote en plein sur mes parcelles. Je fertilise également mes couverts en sortie d’hiver. Ils se développent, les racines travaillent le sol et activent l’activité biologique. Il est important de préciser que j’ai une texture de sol qui favorise la réserve en eau. L’eau n’est pas un facteur limitant sur mon système. Il faut faire attention à ne pas assécher le sol pour la culture qui suit ».
Conclusion
3 points à retenir sur la gestion des limaces sans anti-limaces :
- Se passer d’anti limaces est un risque qui nécessite des pré-requis. Cela demande une réflexion en amont et une vision systémique dans la stratégie de lutte et les pratiques culturales.
- En tant qu’agriculteur, on a indirectement un rôle d’éleveur d’auxiliaires. Nourrir les limaces et protéger les prédateurs des limaces, comme dans la Nature.
- La date de semis et la fertilisation starter sont des éléments intéressants à prendre en compte dans la réflexion.

- La Nature nous offre une vision riche et systémique de la gestion naturelle des limaces dans un cadre d’agriculture de conservation des sols.
Diversification des couverts et rôle des plantes pièges
L’utilisation de plantes pièges ou de couverts diversifiés pour détourner les limaces des cultures principales. Nos essais ont démarrés avec le colza comme leurre, tournesol ou soja, mais d’autres espèces comme la moutarde, le trèfle ou certaines variétés de céréales à croissance rapide pourraient être essayés ou intégrées dans les couverts pour amplifier cet effet. Ces plantes, en plus de nourrir les limaces, peuvent stimuler la biodiversité du sol et attirer davantage d’auxiliaires comme les staphylins ou les araignées, qui sont aussi des prédateurs naturels des limaces. Une rotation bien pensée des couverts peut ainsi devenir une barrière écologique supplémentaire.
Rôle des conditions climatiques et du microclimat
Quand on évoque l’importance des conditions poussantes pour le démarrage des cultures, mais on pourrait préciser comment le climat local et le microclimat parcellaire influencent la pression des limaces. Par exemple, dans des zones très humides ou après des automnes doux, les populations de limaces peuvent exploser. Travailler sur la gestion de l’humidité via le drainage naturel (grâce à l’activité des vers de terre favorisée par les couverts et l’assèchement des profils ) ou l’exposition des parcelles (en évitant les zones trop ombragées) peut compléter la stratégie. Cela renforce l’idée que l’agriculteur doit s’adapter à son terroir spécifique.
Impact à long terme sur la résilience du système
Un aspect intéressant à souligner est l’évolution de la résilience de la démarche au fil des années. En arrêtant les anti-limaces et les insecticides, on a permis à l’ agroécosystème de retrouver un équilibre qui ne repose plus sur des interventions extérieures. On pourrait ajouter que cette approche, bien qu’exigeante au départ (notamment les 2- 3 ans nécessaires à l’équilibre), réduit la dépendance aux intrants chimiques et aux fluctuations de leurs prix. Cela offre aussi une sécurité face aux aléas climatiques ou aux restrictions réglementaires sur les pesticides, un enjeu majeur pour l’avenir de l’agriculture.
Observation et indicateurs de suivi
Pour les agriculteurs qui souhaitent s’inspirer de cette méthode, il pourrait être utile d’ajouter une note sur l’importance de l’observation. J’ai adapté ma stratégie en fonction de mes expériences et observations (pression limaces, mémoire alimentaire, etc.). Des indicateurs simples comme le comptage des limaces avec des pièges (planches ou tuiles posées au sol) ou le suivi des populations de carabes (via des pièges barber) peuvent aider à évaluer l’efficacité de la régulation naturelle et à ajuster les pratiques d’année en année.
Lien avec la santé des sols et des écosystèmes
Enfin, on pourrait relier cette gestion des limaces à des bénéfices plus larges. En favorisant la vie du sol (carbone, auxiliaires, activité biologique), on contribue à stocker du carbone, à améliorer la structure du sol et à réduire l’érosion. Ces sols vivants produisent des cultures plus saines, avec potentiellement moins de résidus chimiques, ce qui profite à la santé humaine et à celle des générations futures. C’est une illustration concrète de la manière dont l’agriculture peut devenir un levier pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires.
« Se passer des anti-limaces chimiques est une démarche qui demande du temps, de l’observation et une approche globale, mais elle offre des solutions durables. En nourrissant les limaces pour détourner leur appétit, en protégeant les auxiliaires qui deviennent des équilibreurs de limaces et en optimisant les dates de semis et la fertilisation, l’agriculteur devient un véritable architecte de son écosystème. Cette stratégie ne se limite pas à gérer un ravageur : elle renforce la santé du sol, la biodiversité et la résilience face aux défis futurs, pour nous et les générations à venir. » - Les auxiliaires sont de véritables acteurs d’un équilibre durable face aux limaces, et le paradoxe des anti-limaces chimiques qui, en perturbant cet équilibre, peuvent aggraver le problème à long terme.
Les auxiliaires : des alliés naturels contre les limaces
Les auxiliaires de culture, tels que les carabes, les staphylins, les hérissons, les crapauds ou encore certaines araignées, jouent un rôle clé dans la régulation des populations de limaces. Ces prédateurs naturels ne se contentent pas d’éliminer une partie des limaces : ils maintiennent un équilibre dynamique qui évite les explosions démographiques de ces ravageurs. Contrairement à une solution chimique, qui agit de manière ponctuelle et indiscriminée, les auxiliaires s’inscrivent dans une logique de long terme. Leur efficacité repose sur la présence de conditions favorables : des habitats préservés (couverts végétaux, haies, bandes enherbées) et une absence de perturbations majeures, comme l’usage d’insecticides ou de molluscicides.
Le piège des anti-limaces chimiques
L’utilisation d’anti-limaces chimiques, souvent perçue comme une solution rapide, peut en réalité se révéler contre-productive. Ces produits, en plus de cibler les limaces, affectent directement ou indirectement les auxiliaires. Par exemple, les granulés à base de métaldéhyde ou de phosphate de fer, s’ils sont mal dosés ou mal appliqués, peuvent intoxiquer les carabes ou les oiseaux qui consomment des limaces empoisonnées. Pire encore, en éliminant une partie des limaces sans réguler leur reproduction, les anti-limaces chimiques créent un vide temporaire qui favorise une recolonisation rapide par les survivantes ou leurs œufs, souvent dans un environnement où les prédateurs naturels ont été affaiblis. Résultat : la dépendance aux traitements augmente, et la pression des limaces devient un problème chronique là où elle aurait pu être maîtrisée naturellement.
Un cercle vertueux avec les auxiliaires
En misant sur les auxiliaires, comme on le fait avec notre système de semis direct sous couverts vivants (SCV) , on enclenche un cercle vertueux. Les couverts végétaux et la vie du sol attirent, nourrissent et protègent ces prédateurs, qui régulent les limaces de manière progressive et durable. Cette approche demande de la patience – souvent quelques années pour que l’écosystème se stabilise – mais elle réduit la dépendance aux intrants et renforce la résilience du système agricole. Les auxiliaires deviennent ainsi les “véritables anti-limaces”, non pas par une action brutale, mais par leur capacité à maintenir un équilibre acceptable, en harmonie avec les cycles naturels.
Une leçon d’écologie appliquée
Ce contraste entre la régulation naturelle et l’approche chimique illustre une leçon fondamentale : en agriculture, lutter contre un symptôme sans comprendre ses causes peut aggraver la situation. Les anti-limaces chimiques, en détruisant les auxiliaires, désarment en quelque sorte le système de ses défenses naturelles, favorisant paradoxalement le développement des limaces sur le long terme. À l’inverse, préserver et encourager les auxiliaires revient à investir dans un capital écologique qui profite à l’ensemble de l’agroécosystème.
« Les auxiliaires de culture sont les véritables héros de cette stratégie. En régulant les limaces de manière naturelle et durable, ils maintiennent un équilibre que les anti-limaces chimiques viennent souvent perturber. En éliminant non seulement les limaces mais aussi leurs prédateurs, ces produits créent un effet boomerang : une fois leur action dissipée, les limaces reviennent en force dans un écosystème appauvri. En misant sur les carabes, les hérissons et autres alliés, on montre qu’une agriculture avec moins de chimie n’est pas une utopie, mais une réalité qui demande de repenser notre rôle : non pas dominer la nature, mais coopérer avec elle. »
Mes autres pistes de recherche…
- On dispose d’informations sur des plantes qui repoussent les limaces grâce à leur odorat sensible. Les limaces, en effet, utilisent leur sens olfactif développé pour détecter leur nourriture, et certaines odeurs fortes ou désagréables pour elles peuvent agir comme des répulsifs naturels. Voici quelques exemples de plantes reconnues pour cet effet, basées sur leurs composés aromatiques :
- L’ail (Allium sativum) : Riche en composés soufrés, l’ail dégage une odeur puissante qui dérange les limaces. On peut planter de l’ail près des cultures sensibles ou utiliser une infusion (ail broyé dans de l’eau) à vaporiser sur les plantes.
- La menthe (Mentha spp.) : En particulier la menthe poivrée, grâce à sa teneur en menthol, produit un parfum intense qui perturbe l’odorat des limaces. Elle peut être disposée en bordure ou mélangée aux cultures.
- Le thym (Thymus vulgaris) : Ses huiles essentielles aromatiques, comme le thymol, créent une barrière olfactive que les limaces évitent. Il est efficace planté autour des zones à protéger.
- Le romarin (Rosmarinus officinalis) : Son arôme camphré et citronné, dû à ses huiles essentielles, repousse les limaces. Il est souvent recommandé en association avec d’autres plantes vulnérables.
- La sauge (Salvia spp.) : Avec son feuillage aromatique riche en composés volatils, elle agit comme un répulsif naturel. Elle est robuste et facile à intégrer dans un jardin.
- L’absinthe (Artemisia absinthium) : Cette plante dégage une odeur amère et forte qui incommode les limaces. On peut l’utiliser en purin ou placer ses feuilles près des cultures.
- La lavande (Lavandula spp.) : Bien connue pour son parfum apaisant pour les humains, elle est irritante pour les limaces grâce à ses huiles essentielles. Elle fonctionne bien en bordure ou en massifs.
- Ces plantes sont plutôt destinées à la gestion des jardins vu leurs coûts économiques …..Ces plantes agissent en exploitant la sensibilité olfactive des limaces, qui préfèrent éviter les zones où ces odeurs dominent. Leur efficacité est renforcée lorsqu’elles sont plantées en barrières ou associées à des cultures sensibles (comme les salades ou les jeunes pousses). Cependant, cette stratégie fonctionne mieux en prévention qu’en cas d’infestation massive, où des méthodes complémentaires (pièges, auxiliaires) peuvent être nécessaires. L’avantage est que ces plantes sont écologiques, souvent décoratives ou utiles en cuisine, et elles favorisent la biodiversité sans nuire aux prédateurs naturels des limaces.
- Le lin ne produit pas d’huiles essentielles ou de composés aromatiques particulièrement forts comme l’ail, la menthe ou le thym, qui sont des répulsifs olfactifs classiques. Son odeur est discrète, et ses feuilles ou tiges ne dégagent pas de parfum notable susceptible de perturber l’odorat sensible des limaces. En revanche, quelques observations permettent de réfléchir à son interaction avec ces mollusques :
- Texture et environnement :
Le lin a des tiges plutôt ligneuses et fibreuses, surtout en fin de cycle, ce qui le rend moins appétissant pour les limaces par rapport à des plantes tendres comme les salades ou les jeunes pousses. Cette texture pourrait jouer un rôle dissuasif physique plus qu’olfactif. De plus, dans un système de semis direct ou sous couverts (SCV), le lin peut contribuer à créer un environnement moins favorable aux limaces en asséchant légèrement le sol grâce à son système racinaire, surtout s’il est associé à d’autres espèces. - Composés chimiques potentiels :
Les graines de lin contiennent des mucilages et des traces de composés cyanogènes (libérant de faibles quantités d’acide cyanhydrique lors de la dégradation), mais ces substances sont peu concentrées dans les parties aériennes accessibles aux limaces. Il n’y a pas de preuve directe que ces composés repoussent les limaces par l’odorat, mais ils pourraient avoir un effet répulsif léger ou toxique si les limaces en ingèrent. - Rôle dans les rotations :
Dans une rotation culturale, le lin est parfois utilisé pour “nettoyer” le sol ou diversifier les habitats, ce qui peut indirectement réduire la pression des limaces en évitant la monoculture (par exemple, après un colza très attractif pour elles). Cependant, cet effet est lié à la gestion globale du système plutôt qu’à une action olfactive spécifique. - Contrairement aux plantes comme la lavande ou le romarin, qui agissent directement sur l’odorat des limaces grâce à leurs huiles essentielles volatiles, le lin n’a pas de mécanisme olfactif marqué. Son effet dissuasif, s’il existe, serait davantage mécanique (texture) ou écologique (diversité dans la parcelle) plutôt que chimique ou aromatique.
Dans des systèmes de cultures associées, le lin est parfois semé avec des plantes comme la camomille (Matricaria chamomilla) ou le fenugrec (Trigonella foenum-graecum).
Camomille : Cette plante dégage une odeur légèrement âcre et contient des composés terpéniques qui peuvent repousser les limaces. En bordure ou mélangée au lin, elle pourrait créer une barrière olfactive naturelle. Des agriculteurs en polyculture rapportent que la camomille réduit les dégâts de limaces sur des cultures voisines, bien que cela reste empirique.
Fenugrec : Connu pour son odeur épicée et ses composés soufrés, le fenugrec pourrait aussi agir comme un répulsif léger. Associé au lin dans une rotation ou un couvert, il diversifie l’environnement olfactif et pourrait détourner les limaces.
Lin dans un couvert multi-espèces :
En semis direct sous couverts vivants (SCV), le lin peut être intégré à un mélange avec des plantes répulsives comme la moutarde (Sinapis alba) ou le trèfle incarnat (Trifolium incarnatum).
Moutarde : Ses composés volatils (isothiocyanates) libérés par les racines et les feuilles ont un effet répulsif avéré sur les limaces. En association avec le lin, elle pourrait renforcer la protection des cultures principales.
Trèfle : Bien qu’il ne soit pas fortement répulsif, son odeur subtile et sa capacité à fixer l’azote enrichissent le sol, favorisant les auxiliaires (carabes, etc.) qui régulent les limaces.
Plantes associées au lin avec effet répulsif olfactif
Voici une sélection de plantes qui pourraient être cultivées avec le lin pour maximiser un effet répulsif via l’odorat des limaces :
Coriandre (Coriandrum sativum) :
Son odeur piquante, due aux aldéhydes et aux terpènes, est désagréable pour les limaces. Plantée en intercalaire avec le lin, elle pourrait créer une zone moins attractive pour ces mollusques tout en attirant des pollinisateurs.
Oignon ou ciboulette (Allium spp.) :
Comme l’ail, ces plantes de la famille des Alliacées émettent des composés soufrés volatils qui repoussent les limaces. La ciboulette, plus facile à intégrer en bordure avec le lin, pourrait être une option pratique.
Tanaisie (Tanacetum vulgare) :
Cette plante produit une odeur camphrée et amère grâce à ses huiles essentielles (thujone). Très efficace contre les limaces, elle pourrait être semée autour des parcelles de lin pour une double action : répulsion olfactive et attraction des auxiliaires comme les coccinelles.
Proposition d’un système pratique
Imaginons une parcelle où le lin est cultivé dans un objectif de gestion naturelle des limaces :
Semis : Lin mélangé à de la moutarde (5 kg/ha) et bordé de tanaisie ou de ciboulette.- Rôle du lin : Il agit comme une culture secondaire ou un leurre mécanique (moins appétissant que d’autres plantes tendres).
Rôle des associées : La moutarde et la tanaisie repoussent les limaces par leur odeur, tandis que la ciboulette renforce la barrière olfactive.
Effet bonus : Les couverts attirent les carabes et autres prédateurs, réduisant encore la pression des limaces.
Ce système s’inspire des principes de diversification et de régulation naturelle, tout en compensant l’absence de répulsion olfactive directe du lin.